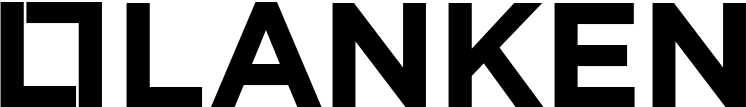Évaluation des actifs non cotés : renforcement des exigences méthodologiques
L’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la Cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA03079), confirmé ensuite par la non-admission du pourvoi devant le Conseil d’État, marque une évolution importante dans l’appréhension des évaluations de titres non cotés lors de contrôles menés sur le fondement de l’article 57 du CGI et de la théorie de l’acte anormal de gestion. La décision renforce les exigences méthodologiques qui pèsent sur les contribuables lorsqu’ils procèdent à la valorisation d’actifs intragroupes, tout en rappelant l’obligation corrélative, pour l’administration, de justifier de manière précise et argumentée toute remise en cause des paramètres retenus.
Dans l’affaire examinée, la valorisation avait été établie au moyen de la méthode des flux de trésorerie actualisés dite « discounted cash flow » (DCF), reposant sur un plan d’affaires à cinq ans, un taux sans risque issu des OAT, une prime de risque de marché prospective et des coefficients bêta adaptés aux différentes activités. La cour souligne que l’administration n’avait contesté ni les flux prévisionnels, ni le taux de croissance, ni les coefficients bêta, mais uniquement le calcul de la prime de risque. Cette absence de critique sur le cœur du modèle confirme la solidité méthodologique de la méthode DCF et son caractère pleinement recevable dans ce type d’opérations, ce que rappelle également la doctrine professionnelle.
Le débat central portait sur la détermination de la prime de risque de marché. Le contribuable avait appliqué une approche prospective, conforme aux pratiques contemporaines des évaluations financières. L’administration défendait, au contraire, une approche historique fondée sur des séries longues de rendements boursiers. La Cour écarte cette approche en rappelant, d’une part, que l’utilisation d’une prime de risque historique est marginale dans les pratiques d’évaluation — les études versées au dossier indiquent que plus de 85 % des évaluations DCF reposent sur une approche prospective — et, d’autre part, que le choix de l’horizon d’investissement ne commande pas la méthode de calcul de la prime de risque. La volatilité du marché au moment de la transaction, déjà intégrée dans les coefficients bêta, rendait inutile toute tentative de « correction » par une moyenne historique.
La décision met également en lumière plusieurs incohérences dans la méthode utilisée par le service, notamment la combinaison d’une prime historique calculée sur le long terme et d’un taux sans risque déterminé sur une période très courte, créant un décalage méthodologique incompatible avec une approche homogène du coût du capital. En l’absence d’argument économique structuré démontrant que ce taux reflétait mieux les conditions de marché à la date de la transaction, la contestation administrative ne pouvait prospérer.
À titre subsidiaire, l’administration avait tenté de corroborer sa valorisation par la méthode des multiples, fondée sur deux transactions internes au groupe datant de 2008. La cour écarte cette comparaison au motif qu’elle repose sur des opérations trop anciennes, réalisées dans un environnement économique différent et sur des périmètres non strictement comparables. La doctrine professionnelle rappelle que la méthode des multiples ne peut constituer un élément pertinent qu’à la condition de s’appuyer sur un échantillon suffisamment large et sur des transactions contemporaines, ce qui ne pouvait être le cas en l’espèce.
Même en retenant certains ajustements proposés par le service, l’écart résiduel entre la valeur vénale recalculée et le prix convenu ne dépassait pas 11 %. La cour rappelle qu’un tel écart ne peut être regardé comme significatif au sens de la jurisprudence relative à l’article 57 du CGI, laquelle réserve la qualification de transfert de bénéfices ou d’acte anormal aux situations dans lesquelles la différence atteint en principe un seuil d’environ 20 %. Cette appréciation contextualisée confirme qu’un écart limité ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une minoration du prix.
Cet arrêt doit, enfin, être lu à la lumière de l’évolution législative relative aux actifs difficiles à évaluer. Le dispositif introduit par la loi de finances pour 2024 renverse, dans certaines hypothèses, la charge de la preuve au détriment du contribuable. La doctrine souligne, toutefois, que ce mécanisme vise principalement les actifs incorporels dont la valorisation est particulièrement incertaine. Les titres de sociétés non cotées n’entrent dans ce champ que s’ils présentent les caractéristiques spécifiques des actifs difficilement évaluables, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire jugée.
L’ensemble de la décision constitue un rappel utile : la sécurité juridique du contribuable repose sur la qualité de la documentation produite au soutien de la valorisation retenue, la cohérence des paramètres financiers et la justification des hypothèses utilisées. En contrepartie, l’administration ne peut remettre en cause une évaluation qu’en motivant précisément sa méthodologie, en s’appuyant sur des données économiques contemporaines et en démontrant que l’écart entre la valeur vénale et le prix de cession est suffisamment significatif pour révéler une anomalie de gestion ou un transfert indirect de bénéfices.
L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des contribuables qui s’appuient sur des évaluations robustes et documentées dès l’origine.