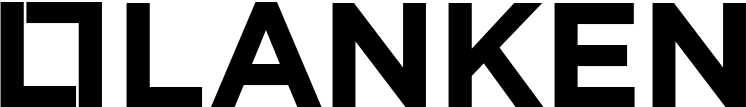Déficits reportables : imputation chronologique et droit de reprise de l’administration fiscale
Le Conseil d’État, par sa décision du 14 novembre 2025 (n° 493824) rendue par les 9e et 10e chambres réunies, vient clarifier deux mécanismes clefs pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : l’ordre d’imputation des déficits reportables et le champ du contrôle de l’administration fiscale sur ces déficits.
La Société Faun Environnement, requérante, ayant subi des résultats déficitaires chroniques (exercices clos entre 2006 et 2009), avait imputé une partie de ces déficits en report sur les résultats bénéficiaires d’exercices ultérieurs et fait l’objet d’une rectification tendant à réduire le stock de déficits reportables au titre des exercices 2013-2014. L’administration fiscale s’appuyait, notamment, sur l’article 209, I, 3e alinéa du Code général des impôts, et sur l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales pour soutenir que le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’exercice au titre duquel l’imposition est due, et que l’existence de déficits reportés pouvait être vérifiée même lorsqu’ils trouvent leur origine dans des exercices prescrits.
Le Conseil d’État opère deux précisions majeures. Premièrement, il affirme que les déficits reportés doivent être imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien dès qu’un exercice fait apparaître un bénéfice. Ceci constitue une confirmation explicite de l’application de la méthode dite « FIFO » (first in, first out) dans le contexte des déficits inlassablement reportables. Deuxièmement, il rappelle que l’administration est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant des déficits reportables issus d’exercices antérieurs, même prescrits, dans la mesure où ces déficits ont été imputés sur un exercice non prescrit ou dont la société tire avantage fiscalement. Toutefois, il nuance en précisant que si un déficit est réputé avoir été intégralement imputé sur des résultats d’exercices prescrits, l’administration ne peut plus redresser ce déficit. En revanche, si un déficit n’a été que partiellement imputé – et qu’il subsiste un reliquat non imputé – le contrôle reste possible dans la limite de ce reliquat.
Sur le plan opérationnel, ces précisions ont pour effet de renforcer la nécessité, pour les sociétés concernées, de documenter l’origine des déficits, leur affectation et l’ordre dans lequel ils ont été imputés. L’anticipation est essentielle : lorsqu’une société affiche des déficits reportables et engage un bénéfice imposable, l’imputation de ces déficits doit être réalisée dans le respect de la chronologie imposée pour préserver les droits à vérification de l’administration. Par ailleurs, la simple constatation d’un déficit issu d’un exercice prescrit ne garantit pas l’irrévocabilité de ce déficit : tant que celui-ci n’a pas été réputé avoir été entièrement imputé sur des exercices prescrits, il reste susceptible de contrôle.
En conclusion, l’arrêt du 14 novembre 2025 contribue à sécuriser la pratique fiscale des déficits reportables en clarifiant l’ordre d’imputation et les conditions de l’exercice du droit de reprise de l’administration. Les entreprises disposant de stocks de déficits et envisageant leur imputation sur bénéfices futurs gagneraient à revisiter leur documentation et leurs politiques d’imputation afin de s’assurer de la conformité de leur démarche avec les nouvelles précisions du Conseil d’État.